Voilà un débat qui a le mérite d’embraser certains forums. Selon certains, dans nos rêves, les visages des individus que nous imaginons ne sont pas inventés de toutes pièces, mais sont ceux de personnes connues ou croisées durant notre vie. En d’autres termes, notre subconscient ne produit pas de nouvelles têtes, mais copie celles qu’il connaît.
Soyons clairs, je n’ai jamais lu d’études qui valident ou infirment cette hypothèse. Je vous donne néanmoins mon point de vue.
Approche macro de nos perceptions sensorielles
La compréhension de notre environnement passe notamment par nos sens. Mais bien souvent, nos souvenirs et notre raisonnement le complètent pour gagner en vitesse.
Par exemple, lorsque l’on croise quelqu’un de familier dans la rue, on est souvent en mesure d’identifier cette personne en un quart de seconde. À cette vitesse, autant dire que nos yeux n’ont pas pris la peine de faire une analyse détaillée. Ils n’ont pas balayé l’ensemble du corps de l’individu ni vérifié chaque détail comme la couleur de cheveux, la forme précise du nez ou de la bouche, la taille exacte ou la corpulence. En fait, tous ces éléments ont été détectés d’un seul coup, en évaluant une correspondance globale : plusieurs associations grossièrement validées suffisent à valider l’ensemble avec certitude.
D’ailleurs, bien souvent, les personnes qui portent des lunettes de vue (correction légère ou modérée) n’ont pas de problème non plus à identifier des connaissances, parfois même sans lunettes. Il en va de même pour la lecture : on ne lit pas les mots “lettre à lettre”, mais on devine une forme globale et approximative. Si vous permutez les caractères d’un mot (en conservant tout de même la première et la dernière lettre à la bonne place), vous serez toujours en mesure de les comprendre sans erreurs. Une longueur (de mot) spécifique couplée à quelques caractères familiers évoque une correspondance unique à un terme appris.
Analogie avec le fonctionnement des IA
Cette logique de forme grossière est un principe abondamment utilisé en intelligence artificielle. Les machines “raisonnent” en effet en “composantes principales”.
Cela est vrai pour des données “simples” et structurées comme une feuille Excel, mais cela s’applique aussi à des modèles plus complexes comme les réseaux de neurones convolutifs ou les LLM (IA génératives de langage).
IA orientées vision : les filtres de convolution
Ces algorithmes de reconnaissance visuelle balayent les pixels d’une image avec un système de fenêtrage (nommé “filtre” ou “noyau”) qui vise à extraire les formes fortes : les angles aigus, les grandes courbes, les zones contrastées, etc. Puis, en combinant ces caractéristiques saillantes, l’algorithme identifie des formes de plus en plus complexes et abstraites (des motifs, voire des visages !).
IA orientées langage : les projections vectorielles
Dans le domaine en vogue de l’IA générative, les LLM utilisent des “embeddings” (projections vectorielles) qui réduisent la quantité d’informations pour construire la quintessence d’un champ de connaissances.
Dit autrement, ces projections (le noyau du savoir des LLM) peuvent être perçues comme la compression sémantique et descriptive d’une réalité complexe de notre monde.
Analogie avec l’humain
Partant de ce double constat sensoriel et IA, il paraît naturel de se dire que les visages formés en rêves sont une combinaison de “formes fortes” plus ou moins subtile, aléatoire et exotique. Parfois, l’assemblage onirique coïncide manifestement avec un individu, mais parfois, la correspondance est moins évidente, voire plurielle (associations à de multiples candidats).
Accepter que notre subconscient joue aux legos revient en quelque sorte à dire qu’il est, dans une certaine mesure, capable de créer des images “de toutes pièces” (ces pièces étant les fameuses formes fortes). On n’est pas sur un calquage clair et explicite d’un visage donné sur le corps d’un autre.
L’accès à la mémoire et l’altération lente des souvenirs
Il y a fort longtemps, j’ai lu un des livres De la Recherche de la Vérité de Malebranche. Et je trouve qu’il proposait une intéressante vision matérialiste de l’imagination et de la mémoire. Si je devais en reformuler l’idée, je dirais qu’on distingue trois aspects dans le processus de mémorisation.
L’encodage
Tout d’abord, l’encodage pur. Le moment où l’on grave le souvenir dans notre encéphale. Nombreux auteurs s’accordent à dire que le contexte dans lequel on se trouve (l’instant présent) joue énormément sur la manière dont on ancre un instant dans son esprit et sur la longévité de ce dernier dans la mémoire. Les émotions, le recul et l’âge du sujet sont autant de facteurs qui vont impacter durablement le souvenir.
Le rappel du souvenir
Ensuite vient l’accès volontaire aux souvenirs. Qu’on le veuille ou non, chaque évocation mémorielle est comme le passage d’une tête de lecture sur un disque : elle laisse une trace microscopique. Chaque souvenir rappelé est remis en perspective au nouveau contexte présent : connaissances actuelles et émotions du moment. Et ce contexte déforme imperceptiblement le souvenir. Et lorsque des décennies s’écoulent, ce fragment de mémoire n’est plus qu’une vague copie de la réalité passée, une relique en ruines, un clone difforme qui fait partie de nos croyances plus ou moins profondes, mais qui remet en question la véracité de notre passé… et par là même, notre identité construite au fil des années.
Les rêves
Enfin, dans le processus de consolidation de la mémoire interviennent les rêves. Ces derniers dénaturent certains de nos souvenirs et leur authenticité se confronte à notre créativité plus ou moins consciente.
La mémoire est en perpétuelle reconstruction. Et ce que nous pensons être du vécu relève parfois de la pure fantaisie. À différents degrés, bien sûr.
On peut d’ailleurs y voir un nouveau parallèle entre l’assemblage onirique et les capacités de création des IA génératives. Elles combinent plus ou moins aléatoirement des formes fortes, puis des motifs plus détaillés issus de son apprentissage (son condensat de savoir stocké dans des bases vectorielles). Et la question de cet article s’apparente aux problèmes juridiques rencontrés dans la création artistique à base d’IA : à partir de quand peut-on considérer que ces créations hybrides conçues sur la base de personnes connues (dans les données d’apprentissage) sont suffisamment remixées pour franchir le seuil subjectif de la pure nouveauté et non du plagiat ?
Conclusion
La manière dont nos sens captent l’information (extraction rapide de formes fortes) et dont notre imagination assemble des pièces détachées rend complexe, voire insensée, la question : le subconscient crée-t-il des visages inconnus ?
En outre, vu comment la mémoire altère et déforme ce que l’on estime être le passé, il serait impossible de vérifier avec exactitude qu’un visage plus ou moins étranger a effectivement appartenu à une personne réelle…
La réponse à la question posée en préambule est trop subjective. En revanche, l’esprit est beaucoup plus impressionnant qu’on ne le pense lorsqu’il s’agit de brouiller notre jugement et de remettre en cause nos certitudes.
C’est là le noyau autour duquel gravite Malgovert : entre identité, souvenirs et songes.

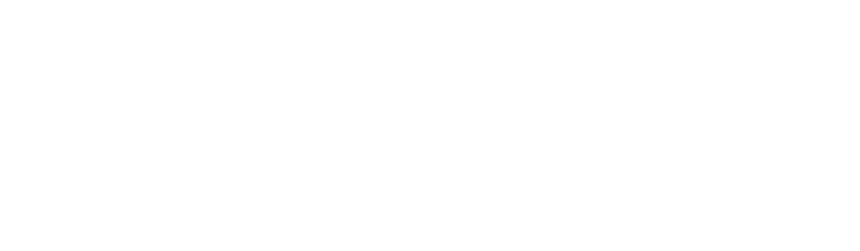

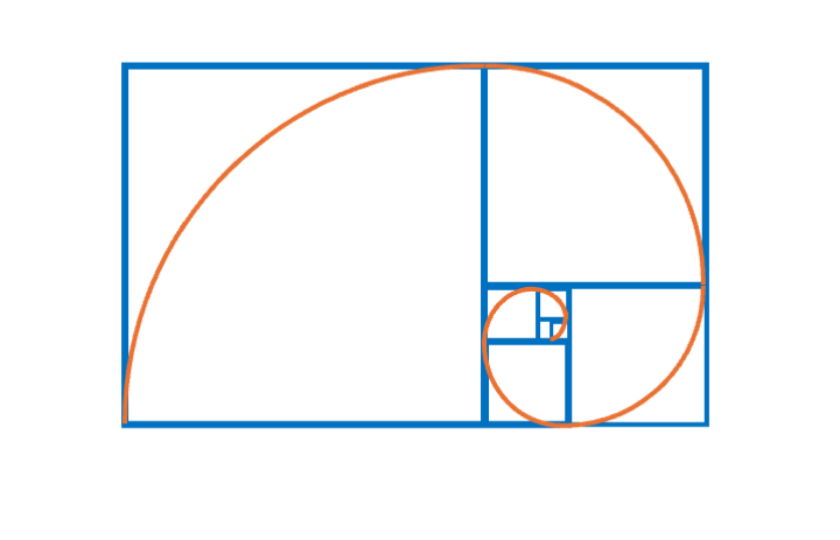

Comment(01)