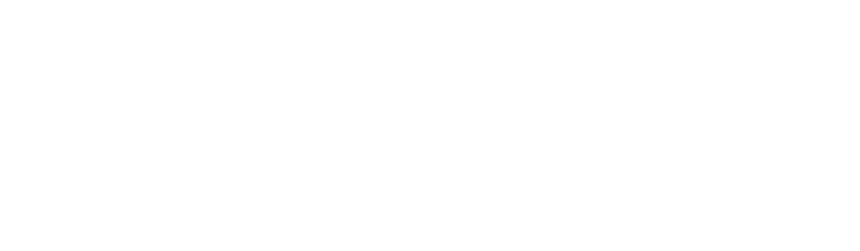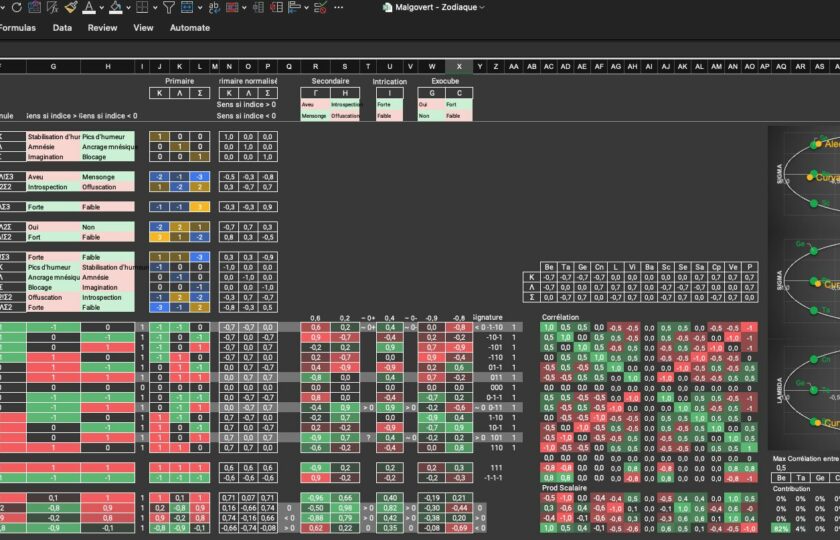Écrire est un moyen de réviser des règles apprises à l’école primaire ou au collège. Voici les principaux écueils. Certains sont anecdotiques, j’en conviens.
Après que + indicatif
On dit “avant qu’il prenne le train” (ou “avant qu’il ait pris le temps”, si on veut du passé), mais on dit aussi “après qu’il a pris le train” (et non pas “après qu’il ait pris le train”). Mieux vaut passer par l’infinitif passé : “après avoir pris le train”.
Quelque vs. Quel que
Quelque(s)
- “Quelques” (au pluriel) a un rôle de déterminant et signifie “une certaine quantité” : il est alors suivi d’un nom. Ex : quelques joueurs.
- Quelque (au singulier) peut avoir :
- À nouveau un rôle de déterminant, suivi d’un nom, pour signifier “peu importe”, ex : quelque raison que ce soit
- Un rôle d’adverbe, suivi d’un nom, pour signifier “environ” (rare). Ex : quelque 5000 personnes
- Un rôle d’adverbe, suivi d’un adjectif ou d’un autre adverbe, pour signifier “même si” (rare), ex : quelque sympathique que ton père soit
Quel que (avec accord)
Cette locution signifie “peu importe” et peut être suivie de “en”, mais est toujours suivie d’un verbe.
Ex : quel que soit le chemin, quelle que soit la raison, quels que soient les joueurs, quelles qu’en soient les conséquences…
Synthèse
En bref, s’il y a un verbe au subjonctif, c’est “quel que” et ça s’accorde et en genre et en nombre. Dans tous les autres cas (noms, adjectifs, adverbes), c’est “quelque”. Et enfin, on met “quelques” devant un nom pluriel.
Les adjectifs qui ne sonnent pas masculins
Pécuniaire (relatif à l’argent) et pénitentiaire (relatif à la prison) se terminent bien par “aire” et donc s’écrivent pareil au masculin et au féminin.
Subjonctif plus-que-parfait dans l’irréel du passé
Dans une subordonnée qui commence par “si”, pour exprimer l’irréel du passé, on a le droit d’utiliser le subjonctif plus-que-parfait pour remplacer non seulement l’indicatif de la subordonnée et le conditionnel de la principale.
Par exemple, la phrase “s’il était arrivé en retard, il aurait été licencié” peut se dire “s’il fût arrivé en retard, il eût été licencié”. Avec des accents circonflexes partout, car c’est le mode subjonctif (et non le passé antérieur de l’indicatif).
Le tréma dans les mots qui se terminent en “gu”.
Il est utilisé pour dissocier une voyelle de la voyelle précédente (séparer les digrammes ou les diphtongues dans d’autres langues).
Par exemple :
- Maïs (qu’on prononcerait “mai”)
- Androïde (qu’on prononcerait “androïde/).
- Noël (qu’on prononcerait “nwouelle” ou “nœl” avec un e dans l’o),
Et viennent les adjectifs en “gu”. Au féminin, il faut écrire :
- Une sirène aiguë
- Une phrase ambiguë
- Une chambre exiguë
- Boire de la ciguë
La réforme de 1990 autorise le placement du tréma sur le “u”. Personnellement, je trouve l’idée intéressante, mais si on le met sur la première voyelle d’une paire qu’on cherche à dissocier, alors pourquoi laisser le tréma sur la deuxième voyelle dans les autres cas ? Si on devait uniformiser l’écriture, on se retrouverait à écrire : mäis, andröide, Nöel, etc. Bref, on se retrouverait avec l’alphabet germanique et scandinave.
Le pluriel des couleurs
Là, on s’attaque à un bon morceau. Le pluriel des couleurs (et des mots composés) est l’une des plus grosses difficultés de la langue française. Si on résume les cinq principales règles :
- Adjectif de couleur dérivé d’un nom (fleur, fruit, métal, animal) = invariable
- Une chemise citron, framboise, orange, marron…
- Exceptions pour : rose, fauve, pourpre, vermeil (et quelques autres) qui sont désormais considérés comme de vrais adjectifs et plus seulement de noms
- Deux noms/adjectifs de couleur combinés (avec trait d’union !) = invariables
- Des chemises bleu-gris, bleu-vert
- Les bleu-vert de l’océan
- Couleur avec complément ou couleur introduite par l’expression “couleur de”
- Adjectif de couleur = tout invariable : des chemises jaune d’or, bleu de nuit, couleur noisette, couleur de miel
- Note : “elle est vert(e) de peur” s’accorde, car “peur” n’apporte aucune nuance de couleur
- Nom de couleur = accord de la couleur (ainsi que du mot “couleur” lui-même), mais pas du complément : les jaunes d’or, les bleus de nuit, les couleurs noisette, les couleurs de miel
- Couleur avec mot apposé
- Adjectif de couleur avec mot apposé = invariable : des chemises vert foncé, bleu ciel, bleu turquoise, jaune orangé, blanc neige, blanc cassé
- Nom de couleur avec mot apposé = accord du nom de couleur ; quant au mot apposé, deux cas :
- Si le mot suivant est un nom (qui n’est pas une couleur), alors le mot suivant reste invariable : les bleus ciel, les verts pomme
- Si le mot suivant est un adjectif, alors tout s’accorde : les bleus foncés, les jaunes orangés, les blancs cassés
- Adjectifs de couleur coordonnés
- Des drapeaux bleu, blanc, rouge ; des drapeaux bleu, blanc et rouge (tricolores)
- Des drapeaux bleus, blancs et rouges (plusieurs drapeaux monocolores)
- Trois drapeaux bleu, blanc et rouge (trois drapeaux unicolores : un bleu, un blanc, un rouge)